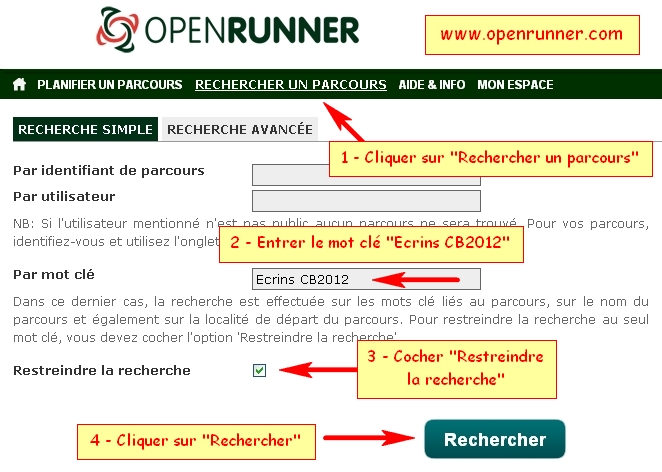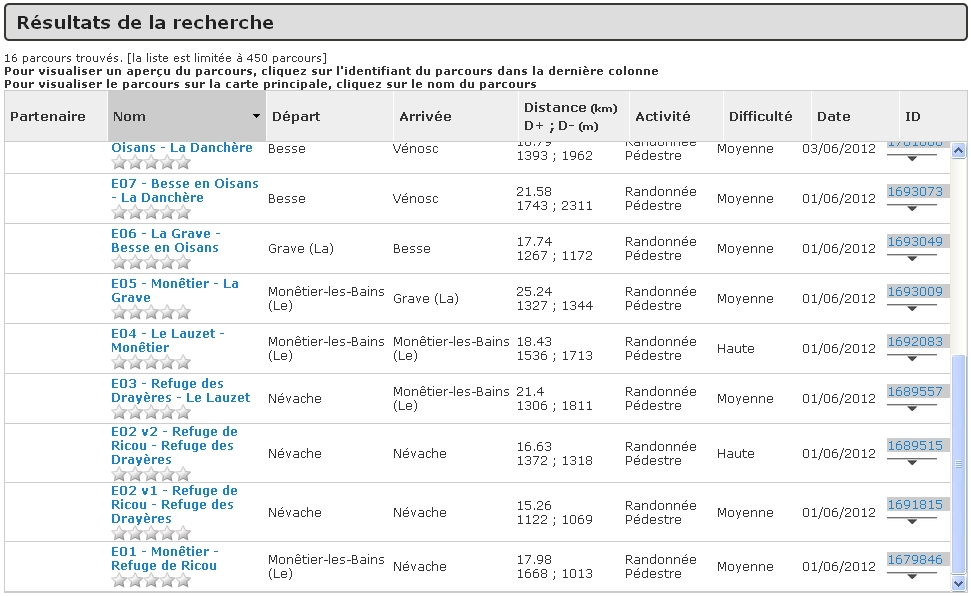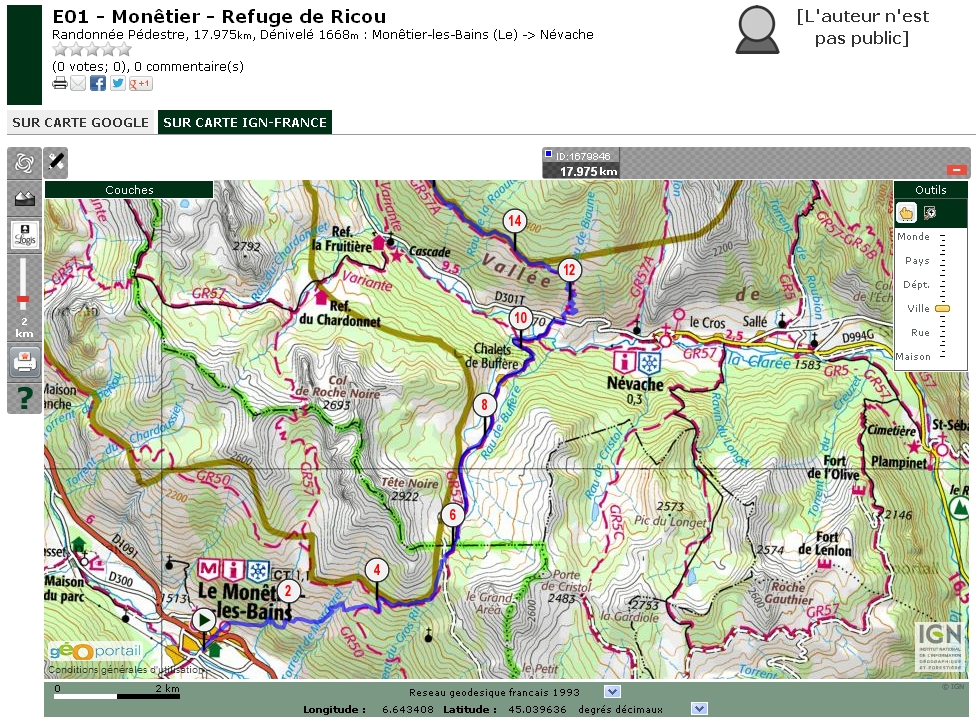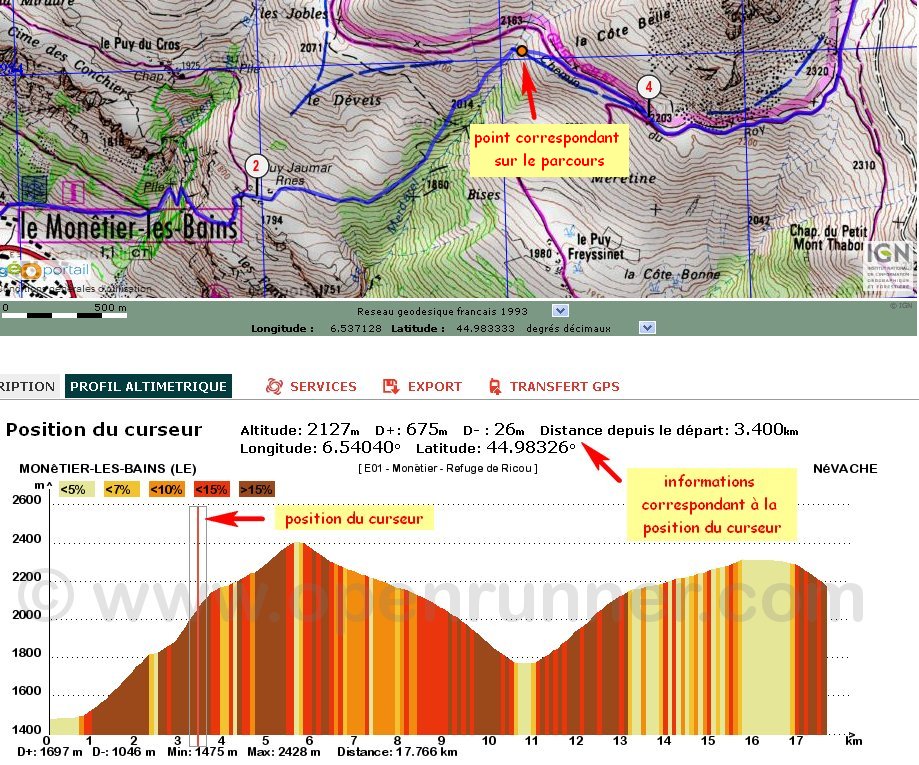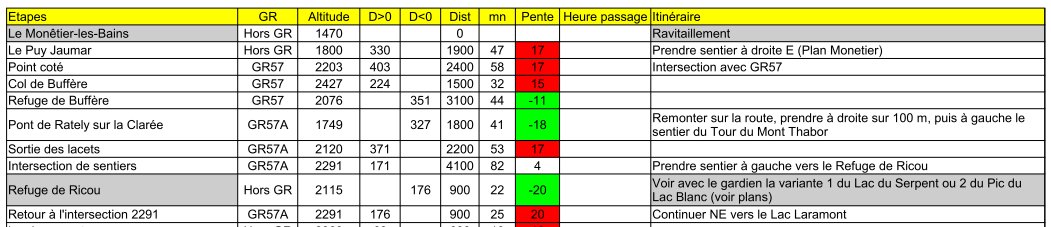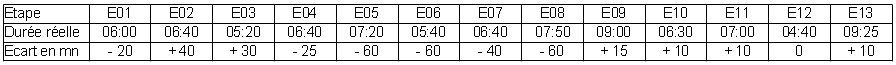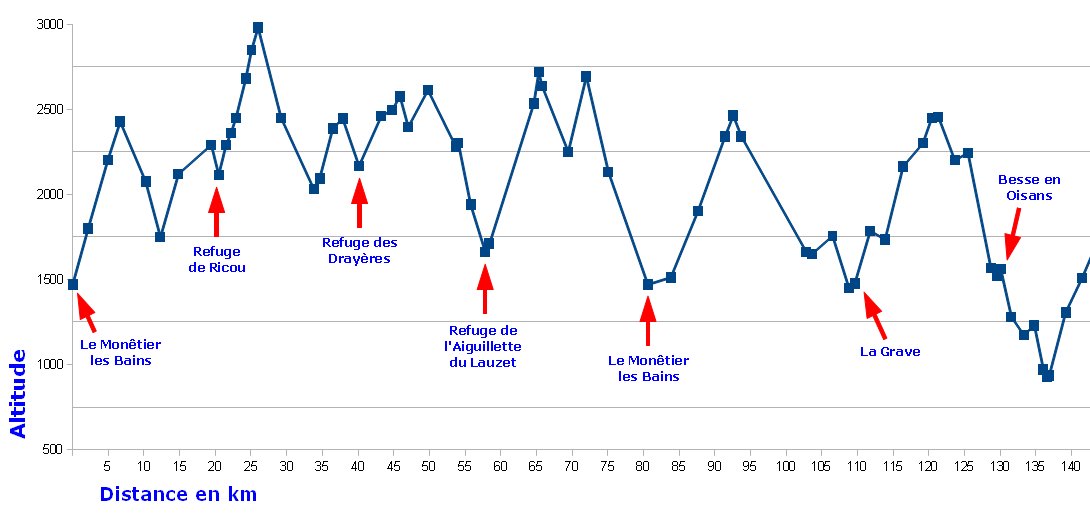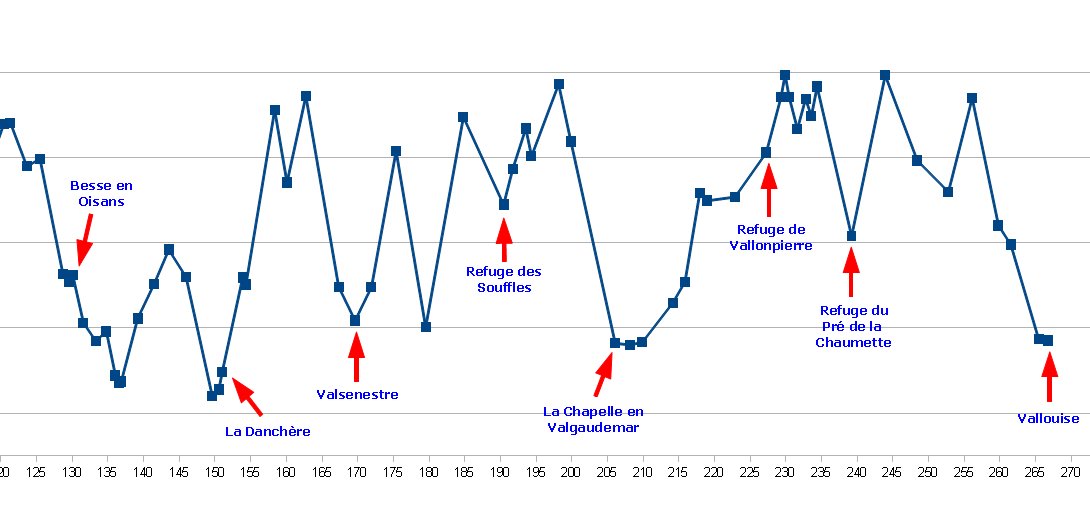La
préparation de l'itinéraire
Pour préparer l'itinéraire,
j'ai utilisé le Topoguide de la FFRP, la carte E6 Ecrins de Rando Editions
et les sites internet Géoportail
et Openrunner.
1. Topoguide et cartes
Le Topoguide permet de mettre
en place assez facilement la structure générale du Tour des Ecrins
avec le découpage des différentes étapes en fonction des
hébergements. Par contre, si on veut rechercher des variantes, on peut
consulter la carte A6 Ecrins qui donne l'ensemble des sentiers dans la zone
concernée. Finalement, je n'ai emporté que la carte A6 Ecrins
pour cette randonnée et j'ai imprimé les informations complémentaires
sur des feuilles séparées : liste des hébergements avec
les informations associées (tarifs, arrhes, téléphone,
douche...) ; points de passage caractéristiques avec altitude, distance,
temps de parcours estimé, sites intéressants à voir ; détails
d'itinéraires à partir des cartes IGN agrandies sur Géoportail
ou Openrunner (par exemple la descente dans le Grand Bois sur Vallouise)...
| 
|
Réf. 508 (13ème édition - avr. 2011), Echelle 1/50000, Format
13,5 x 21 cm, Couleur, Prix 14,90 €
Les
randonneurs sportifs mettront entre 11 et 13 jours pour effectuer le grand
tour en suivant le GR54. Plusieurs variantes (GR54A, GR54B et GR54C) permettent
de bâtir des parcours moins exigeants sur 2 ou 3 jours. Enfin, le GR541
qui relie le Pas de la Cavale à Saint-Crépin et sert de raccordement avec
le Tour du Queyras, permet de découvrir la riante vallée de Fressinières
et ses alpages.
Avantages
: Le parcours historique est décrit en détail avec
les hébergements et curiosités.
Inconvénients :
Echelle au 1/50000, les autres sentiers n'apparaissent pas
sur la carte, rien évidemment sur le Massif des Cerces.
|
| 
|
N°A6 ECRINS, Editeur RANDO EDITIONS, Série Cartes Rando éditions
50K, Echelle 1/50000, Prix environ 10 €
Cette
série de cartes est réalisée sur la base des fonds topographiques de l'Institut
national de l'information géographique et forestière (anciennement IGN),
avec surimpression des itinéraires de randonnées et de promenades à pied,
à ski, à VTT. Localisation des refuges gardés, gîtes d'étape, Rando'Plume,
campings, zones de bivouac, indications d'ordre touristique, culturel
et sportif.
Avantages
: Tous les sentiers apparaissent sur cette carte, ce qui permet
un choix plus varié d'itinéraires. Le Massif des Cerces
apparaît sur la carte, à l'exception d'une très petite
zone vers le Col des Rochilles.
Inconvénients
: Echelle au 1/50000, fond de carte IGN de 2005. |
2. Géoportail
Il convient aussi de s'assurer
que les variantes envisagées existent bien sur les cartes au 1/25000
et dans la réalité. Sur le site de Géoportail,
on peut visualiser n'importe quelle carte IGN avec une échelle pouvant
aller jusqu'au 1/10000, c'est dire si les détails des cartes IGN classiques
au 1/25000 apparaissent très nettement. Une autre fonctionnalité
très utile de Géoportail consiste à superposer une carte
IGN avec la photo aérienne correspondante. Pour l'Isère et les
Hautes Alpes, les photoaériennes ont été prises en 2009.
On peut ainsi voir si un sentier existe toujours, enfin en théorie...
Par contre, je ne connais pas la date de révision des fonds de carte
utilisés par Géoportail.
3. Openrunner
Openrunner
est un site très intéressant que j'ai découvert lors de
la préparation de cette randonnée. J'en avais déjà
entendu parler par des amis cyclotouristes qui l'utilisent pour préparer
leurs circuits, mais je ne savais pas qu'il pouvait également être
utilisé par les randonneurs. Avec Openrunner, on dispose des fonds de
cartes IGN (les mêmes que sur Géoportail) sur lesquels on peut
tracer un itinéraire, l'enregistrer dans un espace personnel pour le
retrouver ultérieurement ou le partager avec d'autres personnes (avec
un mot clé pour en faciliter la recherche)...
Tous les fichiers qui décrivent les différentes étapes
(et que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien adéquat)
sont en fait des copies d'écran issues d'Openrunner. Pour visualiser
les étapes avec Openrunner, il suffit de suivre les indications ci dessous.
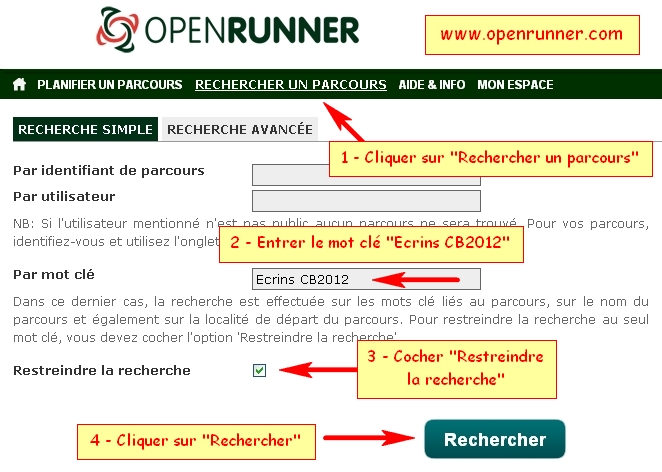
Toutes
les étapes apparaissent dans la feuille de résultats.
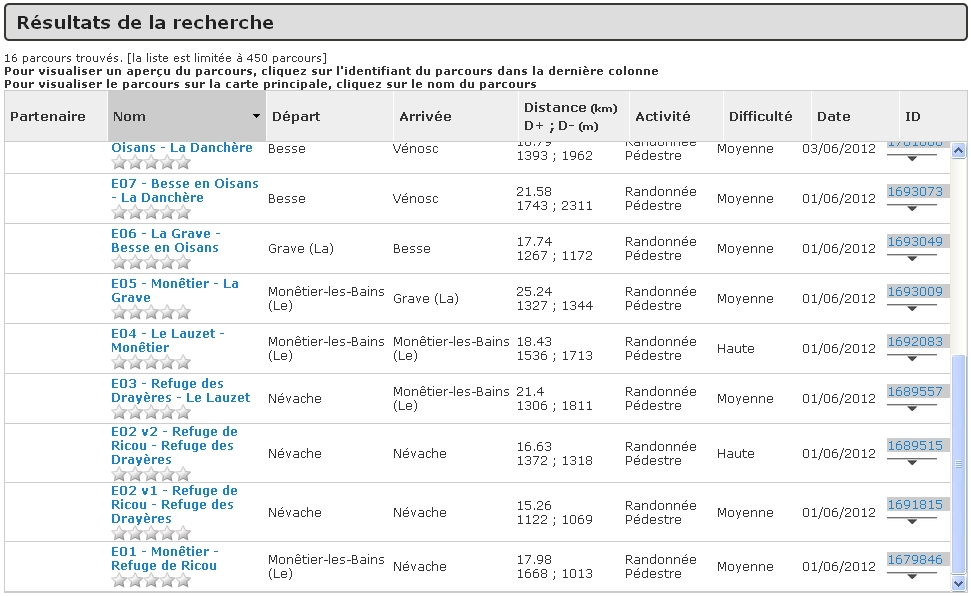
Pour visualiser une étape,
il suffit de cliquer sur son nom (par exemple E01 - Monêtier - Refuge
de Ricou). Mais n'oubliez pas de cliquer sur l'onglet "SUR CARTE IGN-FRANCE"
pour visualiser le parcours sur fond de carte IGN, car par défaut, le
tracé apparaît SUR CARTE GOOGLE. Ensuite vous pouvez zoomer à
l'aide du curseur situé sur la droite (actuellement sur la position Ville).
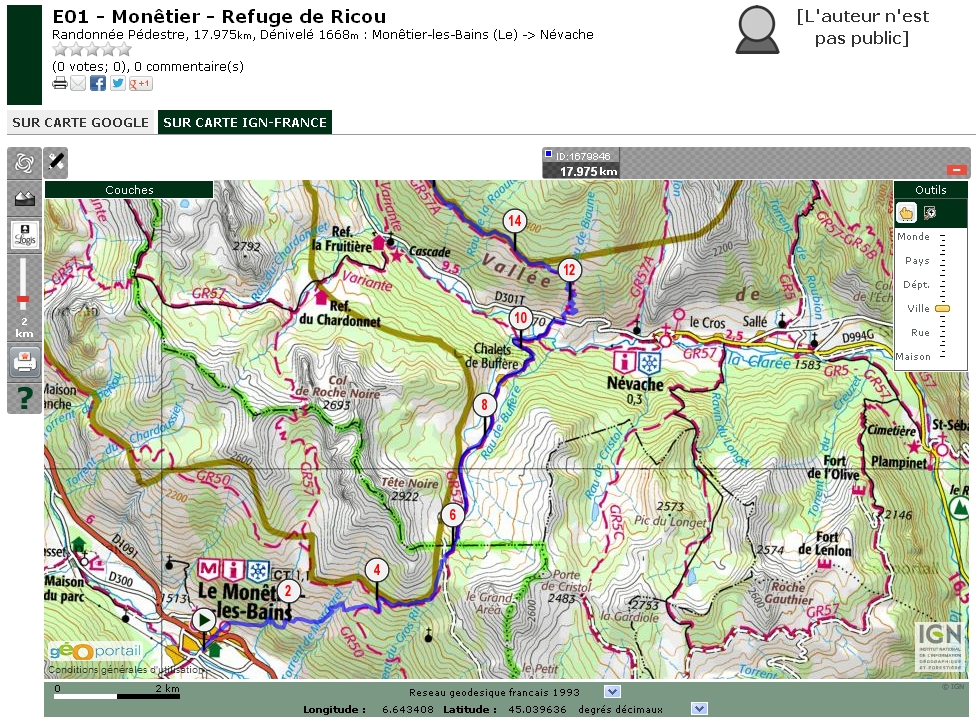
Pour chaque parcours enregistré,
on peut afficher la distance, les dénivelées cumulées, positives et négatives,
et le profil altimétrique sous forme d'un graphique très parlant. Déplacer
le curseur présent sur le profil altimétrique a pour effet de déplacer un point
le long du parcours sur le fond de carte et permettre ainsi de localiser plus
précisément les parties délicates du parcours. Pour chaque point ses coordonnées
GPS, son altitude, les dénivelées cumulées positive et négative depuis le départ
et la distance parcourue sont indiquées.
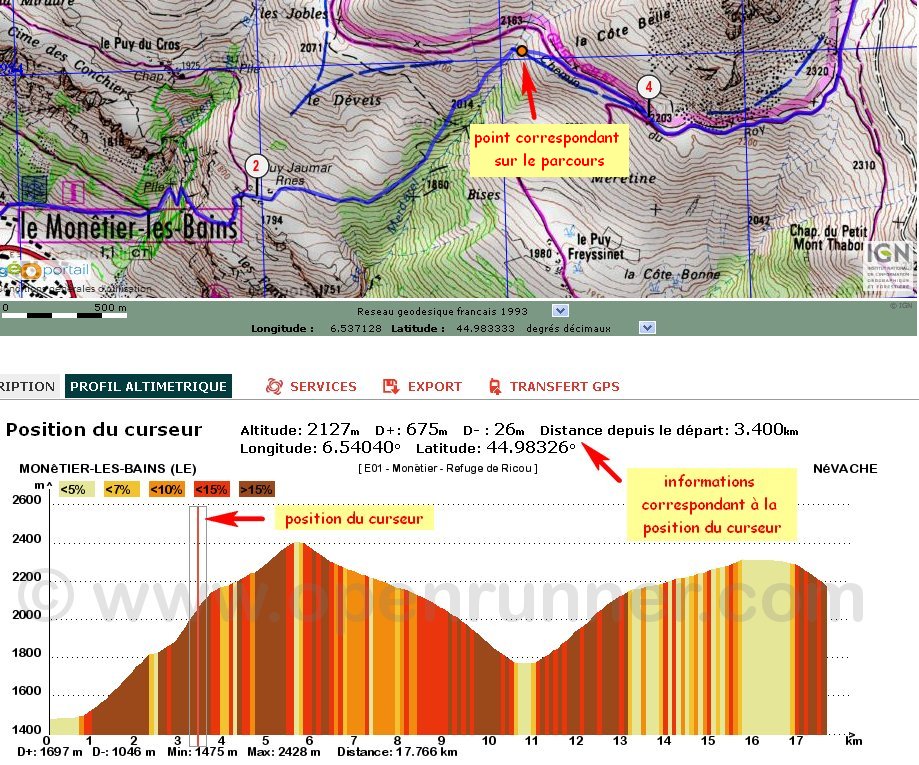
Evidemment, à partir de ces informations très détaillées,
il est tentant de calculer les dénivelées, les distances et d'estimer
les temps de parcours pour chaque étape. C'est ce que j'ai essayé
de faire cette année et voici mon retour d'expérience que je vais
détailler pour ceux que cela intéresse...
4.
Estimation des temps de parcours
Avant le départ, j'ai enregistré sur un tableur tous les points
caractéristiques de chaque étape : le point de départ,
d'arrivée et tous les points intermédiaires où il y avait
un changement de direction et/ou une rupture de pente significative. Pour chaque
point, j'ai noté l'altitude et la distance depuis le départ de
l'étape. En voici un exemple sur la première étape :
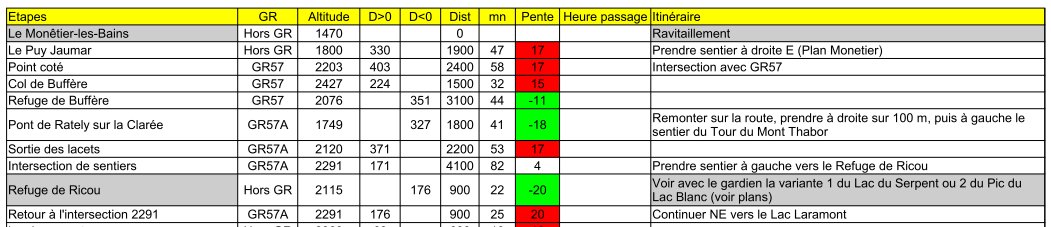
J'ai ensuite calculé pour chaque tronçon la dénivelée
positive (D>0) ou négative (D<0) et la distance linéaire
(Dist) en repérant les coordonnées des extrémités
des tronçons par déplacement du curseur sur le profil altimétrique
d'Openrunner de l'étape comme je l'ai indiqué plus haut. J'ai
déterminé la pente positive ou négative de chaque tronçon
en % en divisant la dénivelée par la distance et en multipliant
par 100. Ainsi, par exemple, le tronçon "Le Monêtier les
Bains - Le Puy Jaumar" a une dénivelée positive de 330
m, une longueur de 1900 m et une pente de + 17 % (soit 17 m de dénivelée
positive pour 100 m de distance).
Ensuite j'ai essayé d'estimer le temps nécessaire pour parcourir
chaque tronçon. Comme je connais la pente, le distance et la dénivelée
entre deux points consécutifs, j'ai utilisé l'algorithme suivant
:
1. Si la pente est inférieure à un seuil déterminé
SP (par exemple 10 %), je considère que
je vais parcourir ce tronçon à une vitesse moyenne (sur la distance)
VB fixée à l'avance (par exemple 3000
m/h). Si ça monte, j'irai peut être un peu moins vite,
mais si ça descend, j'irai plus vite. Statistiquement, cela doit se
compenser. Je divise donc la distance par la VB pour obtenir la durée
du parcours. En fait, tout se passe comme si je marchais sur un parcours horizontal,
mais à une vitesse plus faible que la normale (on porte quand même
un sac de 12 kgs).
2. Si la pente est supérieure à SP et si la dénivelée
est positive, je considère que je monte à une vitesse de montée
(par rapport à la dénivelée) VM déterminée
(par exemple 420 m/h). Si la pente est supérieure
à SP et si la dénivelée est négative, je considère
que je descend à une vitesse de descente (par
rapport à la dénivelée) VD
déterminée (par exemple 480 m/h).
Je divise donc la dénivelée par VM ou VD. Cette fois-ci, c'est
la dénivelée qui détermine le temps et non la distance.
Les paramètres SP, VB, VM et VD peuvent être modifiés
dans les cases adhoc du tableur et toutes les durées sont alors recalculées
automatiquement. Les durées en minutes apparaissent dans la colonne
mn. Il suffit enfin de sommer les valeurs des tronçons pour obtenir
les dénivelées positive et négative globales, la distance
et le temps de parcours de chaque étape. Lors de la préparation,
j'ai choisi les valeurs comme indiquées précédemment
et pendant la randonnée, j'ai essayé de noter les durées
réelles pour vérifier si mes données estimées
avaient quand même quelque chose à voir avec les valeurs réelles.
Alors, quels sont les résultats ? Ils sont plutôt satisfaisants
et sont représentés ci dessous. La ligne Ecart en mn représente
la différence entre la Durée réelle et la Durée
estimée avec la méthode détaillée précédemment.
Si l'écart est positif (resp. négatif), cela signifie que la
durée de l'étape a été plus longue (resp. moins
longue) que prévu.
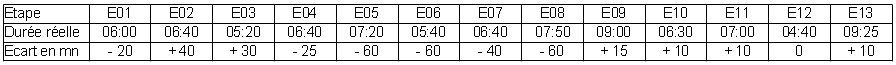
On
peut trouver des explications aux écarts les plus importants.
Une partie de l'étape E02 se déroulait hors
sentier dans
un terrain assez délicat
lors de la descente du Pic du Lac Blanc. Lors de l'étape E03, il fallait
emprunter une cheminée câblée avec pas mal de randonneurs
(et même de jeunes enfants), ce qui nous a obligé à patienter
un bon moment. Dans les étapes E05, E06 et E07, il y avait de longues
portions peu pentues (du Pas d'Anna Falque à Villar d'Arène,
Plateau d'Emparis, Contournement des Deux Alpes) où notre moyenne horaire
était bien supérieure à 3 km/h. L'étape E08 était
notre première grande étape de montagne avec uniquement de fortes
pentes positives et négatives (Col du Vallon et Col de la Muzelle)
et nous avons gagné beaucoup de temps dans les descentes. Cette situation
ne s'est pas reproduite dans l'étape E10, car la descente du Col de
la Vaurze vers le Refuge des Souffles comportait une longue traversée
à flan de montagne qui paraissait plus ou moins horizontale sur la
carte et qui s'est révélée plus importante en longueur
et en dénivelée avec une succession de montées et de
descentes.
5. Estimation des distances
Elle
a été faite à partir des données relevées
sur les cartes et les profils altimétriques d'Openrunner. Elle est
donc directement liée à la précision des tracés
sur les cartes. On comprend assez facilement que le tracé ne pose pas
de problème sur les portions peu accidentées, mais il devient
très difficile, voire même impossible, de reproduire toutes les
sinuosités des sentiers de montagne dans les pentes les plus raides.
D'ailleurs, les tracés sur les cartes IGN montrent de petits zigzags
qui ne représentent pas vraiment la réalité. Pour illustrer
mes propos, il suffit d'aller voir la photo "Vallouise01.jpg" prise
lors de la dernière étape pour voir ce qu'est réellement
un sentier de montagne dans une zone pentue. Il conviendrait donc de majorer
les distances proposées par Openrunner de 10 à 20 % en fonction
des pentes rencontrées aussi bien à la montée qu'à
la descente. Comme il est illusoire de mesurer les distances réelles
avec un podomètre, j'ai systématiquement majoré les distances
proposées par Openrunner de 15 %.
6. Estimation des dénivelées
Lors
de la préparation de l'itinéraire, j'ai remarqué que
les dénivelées données par Openrunner sont assez éloignées
de celles que j'ai relevé à la main sur les cartes. Parfois
l'erreur dépasse 20 % (souvent en plus). Comme je relève très
soigneusement les altitudes des points hauts et bas, je me suis dit qu'il
y avait forcément un problème quelque part. Comment procède
Openrunner ? Je pense qu'il calcule l'altitude de chaque point défini
par l'utilisateur en fonction de sa position sur la carte. Comment se repère-t-il
? Mystère, mais il faut très souvent faire de gros zooms sur
les courbes de niveau pour avoir une bonne estimation. L'altitude peut être
repérée à 10 ou 20 mètres près dans les
zones montagneuses là où les courbes de niveau sont visibles.
Pour analyser plus finement la cause de toutes ces erreurs, imaginons qu'Openrunner
soit plus malin que moi (c'est pas dur...) et estime l'altitude avec une erreur
de 5 mètres. Supposons maintenant un parcours qui se déroule
rigoureusement à la même altitude, par exemple 875 m, constitué
de 20 points consécutifs. Supposons qu'Openrunner définisse
les altitudes comme suit : 870, 880, 870, 880... jusqu'au vingtième
point. Lorsqu'il va calculer les dénivelées, il va trouver entre
deux points consécutifs une montée ou une descente de 10 mètres,
soit une dénivelée positive de 100 m et une dénivelée
négative de 100 m alors qu'on est resté rigoureusement à
la même altitude. Sachant qu'il faut un grand nombre de points pour
définir un itinéraire, on voit tout de suite que ce mode de
calcul peut conduire à des écarts importants !
L'erreur sera d'autant plus grande si le parcours est un peu vallonné.
Par contre, lorsqu'on a des montées (ou des descentes) régulières
avec une pente significative, les erreurs vont se rattraper naturellement.
Dans le cas d'une montée, si un point est coté trop bas, comme
le suivant sera coté nettement plus haut, il n'y aura pas d'erreur
sur l'ensemble de la montée. Idem dans le cas d'une descente. Ce sont
donc les zones à faible pente (voire sur le plat) qui posent problème,
car la détermination des altitudes peut conduire à des erreurs
qui vont se cumuler parfois de façon importante.
Finalement, j'ai décidé de faire confiance à mes relevés
manuels et de vérifier tout cela sur le terrain lorsque je relèverai
les cumuls de dénivelée indiqués par mon altimètre
! Après analyse des résultats donnés par mon altimètre,
je constate que mes relevés sont tout à fait satisfaisants,
excepté lorsqu'il y a des montagnes russes même de faible amplitude
que je n'ai pas détecté sur les cartes, comme par exemple entre
le Col de la Vaurze et le Refuge des Souffles, où j'ai relevé
2358 m de D>0 (au lieu de 2231 m) et 1682 m de D<0 (au lieu de 1550
m). Si on considère les autres étapes, les valeurs données
par l'altimètre sont supérieures d'environ 3 à 4 % aux
valeurs relevées sur les cartes. On peut donc considérer cela
comme un bon résultat.
Voici
le graphique du parcours global.